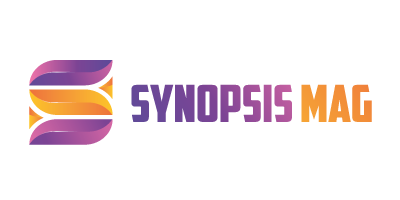Entre 2008 et 2023, la population du Burundi est passée de 8 à plus de 13 millions d’habitants, selon les données officielles. Ce rythme place le pays parmi ceux ayant l’un des plus forts taux d’accroissement démographique au monde.Les projections démographiques anticipent un doublement de la population en moins de vingt-cinq ans. Une telle dynamique bouscule les équilibres économiques et sociaux déjà fragilisés, alors que les ressources disponibles restent limitées et que l’économie peine à suivre.
Une population en forte croissance : le visage démographique du Burundi aujourd’hui
En six décennies, la courbe démographique du Burundi a pris des allures vertigineuses : 2,8 millions d’habitants en 1962, près de 13 millions aujourd’hui. Peu de pays africains ont connu un tel bouleversement. Sur ce territoire modeste et enclavé, la densité atteint des sommets, bien au-delà de la moyenne régionale. La pression s’est installée, palpable dans chaque recoin du pays.
Quelques chiffres montrent l’ampleur de la mutation :
- 80 % des Burundais ont moins de 35 ans. Une jeunesse foisonnante, pleine de vitalité, mais aussi confrontée à l’impatience, à l’attente, à la déception.
- Une croissance démographique rapide qui pèse de tout son poids sur les terres cultivables, morcelées à l’extrême, exploitées jusqu’à l’usure.
Sur place, rares sont les familles comptant moins de cinq enfants par femme : une tradition qui maintient la dynamique démographique à plein régime. Mais pour les jeunes Burundais, chaque année qui passe accroît l’incertitude. Le manque d’emplois pousse une partie d’entre eux à tenter leur chance dans les villes, ou au-delà des frontières, notamment vers la République démocratique du Congo.
La surpopulation se traduit tous les jours par une compétition acharnée pour l’accès à la terre, à l’eau, aux services collectifs. Les classes débordent d’élèves, les files d’attente s’allongent à l’hôpital, les marchés saturent. Les tensions montent. Le Burundi ne peut repousser ses frontières, ni inventer soudain de nouvelles ressources. Reste alors à négocier avec une densité qui ne cesse de croître, et multiplie les déséquilibres.
Quels liens entre explosion démographique et pauvreté persistante ?
La pauvreté accompagne fidèlement la montée de la croissance démographique. Difficile d’édulcorer : près de 87 % des habitants survivent avec moins de 1,9 dollar par jour, et plus de six millions font face à l’insécurité alimentaire. Les marges sont réduites au minimum, chaque ressource se transforme en enjeu vital.
On observe deux grands mécanismes qui verrouillent la situation génération après génération :
- La jeunesse burundaise dominante, souvent sans travail, avec pour horizon une précarité tenace.
- Le surpeuplement qui aggrave la fragmentation foncière et épuise chaque mètre carré de terre arable.
Ce sont d’abord les enfants qui paient le prix fort : la malnutrition progresse, l’accès à l’éducation patine, les soins se raréfient. La démographie s’accélère, la demande grimpe mais les écoles, les infrastructures agricoles, les dispositifs de santé n’avancent pas au même rythme. Résultat : six Burundais sur dix vivent aujourd’hui en insécurité alimentaire aiguë.
Ce piège n’est pas propre au Burundi, mais il s’y referme avec une acuité redoutable. Les ressources diminuent, les terres perdent en fertilité, les jeunes manquent de perspectives. L’équilibre devient de plus en plus précaire, et le pays s’expose à une vulnérabilité extrême.
Les défis économiques majeurs aggravés par la pression démographique
La pression démographique ébranle tout le tissu économique du pays. En soixante ans, la population a quadruplé ; chaque secteur en ressent les secousses. L’agriculture emploie encore la grande majorité, mais avec des terres toujours plus petites et des rendements en stagnation. L’équation budgétaire est tendue : déficit de -9,1 % du PIB en 2023, dette publique culminant à 62,8 % du PIB.
La monnaie nationale, le franc burundais, recule face aux spéculateurs. L’inflation grignote le moindre achat, rogne le quotidien. Les classements mondiaux ne laissent guère de place au doute : le Burundi figure en bas de l’indice de développement humain, et reste mauvaise élève pour le climat des affaires, malmené par la corruption, le manque de clarté, l’incertitude réglementaire. Les investisseurs préfèrent regarder ailleurs.
Deux aspects fragilisent encore davantage le pays :
- Sa dépendance croissante aux bailleurs de fonds internationaux, assortie de conditions drastiques et de marges de manœuvre réduites.
- La faiblesse de la valorisation des ressources minérales, rares et précieuses mais encore mal exploitées sur place.
À ce rythme, la vigueur démographique submerge les effets des rares progrès économiques. Les réformes traînent, les perspectives restent figées. Pour la jeunesse du Burundi, le sentiment d’un présent qui stagne domine ; les attentes d’un emploi, d’une chance, d’une visibilité sur l’avenir continuent de s’accumuler.
Des pistes pour répondre aux enjeux économiques et sociaux du Burundi
Face à cette situation, l’éducation et la formation professionnelle s’imposent comme leviers immédiats. Impossible de faire l’impasse : une jeunesse aussi vaste ne peut rester à l’écart du progrès. Relancer les écoles, miser sur l’apprentissage technique, investir dans la transmission de compétences : chaque pas compte pour rendre les jeunes capables d’agir, de bâtir, d’espérer une place.
Un autre axe se dessine : le renforcement de l’autonomie des femmes. Sur le terrain, les femmes qui accèdent au microcrédit, qui montent leur activité, qui jouent un rôle dans l’économie locale changent la donne. À chaque avancée vers plus d’égalité, c’est toute la société burundaise qui bénéficie d’un élan nouveau, avec davantage de stabilité et d’inventivité.
Rien ne tient sans cohésion sociale. Les clubs de jeunes, les projets communautaires, l’engagement religieux : ce sont eux qui stabilisent le tissu social quand l’État faiblit. C’est là, dans ces structures de proximité, que les tensions se dissipent, que les plus fragiles trouvent appui et répit.
Pour sortir de l’étau, le Burundi peut aussi miser sur une exploitation responsable de ses ressources minérales et le développement d’infrastructures, à l’image du projet ferroviaire SGR. Localiser la valeur, assurer la transparence, organiser un partage juste de la richesse : ce sont les étapes clés pour transformer la croissance démographique en moteur réel de progrès. La volonté politique, et la capacité collective à agir, feront toute la différence. Le compte à rebours a commencé : le chemin reste ouvert, mais il faudra marcher vite et droit.